Contort yourself, oh, contort yourself
Hey, baby, you better twist it, oh
You'll never, never, never resist it
Contort yourself, contort yourself, oh
23 mai 2024.– Averses orageuses, toujours pas de beau temps (20°C). Labeur immanquablement sinistre, fatigue corrélative. Court retour dans les Cahiers de l’ami Cioran, qui ne se sent pas en dehors de la société, mais plutôt en dehors de l’humanité, avec une vie qui n’est qu’une « suite de cessations ». En complément, trois pages du Journal de Renard, qui lui pense parfois écrire une sorte de « littérature de furet ».
24 mai 2024.– Tempo sempre tempestoso (20°C). Alba alle 5:00. Lavoro. Siesta. Niente letto. Giornata inutile.
25 mai 2024.– Un peu de soleil, enfin (23°C). Lever à 8 h 00, douche, petit-déjeuner, 15 km de vélo (chemin faisant, récupéré Sur le fleuve Amour de Joseph Delteil dans une boîte à livres). Douche à nouveau, lecture de L'Équipe du jour, puis 10 km à pied agrémentés de belles pauses de lecture (en gros, vingt minutes de marche, trente minutes de lecture). La première m'a permis d'entamer Canisy de Jean Follain dans une sorte de sous-bois où l'on a cru bon de poser un banc public propice aux lecteurs égarés. Rien à redire, le tout était merveilleux. Le banc public perdu dans le sous-bois, et Follain aussi, surtout Follain. Dans Canisy, il raconte les lieux de son enfance avec une prose d'apparence simple, mais avec un ton et des couleurs qui ne doivent pas être si simples que ça à trouver (on parlera de simplicité naturellement travaillée). Pour vous donner une petite idée de ce qu'est son texte, il y a une page où, marchant dans la boue et voyant se fixer sous son pas le dessin de ses semelles, il se met à penser que la fugace trace d'une paire de chaussures à clous sur la poussière d'un chemin plus sec représenterait encore mieux un « sentiment émouvant de l'univers ». C’est pas mal, c’est très beau, c’est tout simple… Ceci lu et dit, sur les coups de midi, retour vers mon petit intérieur. Ménage à base de vifs coups de plumeau vialiattien, puis déjeuner : salade verte, poisson et tomates que l'on dit provençales, fromage et petit blanc. Joué ensuite un peu avec le chat de la voisine qui a fini ses cabrioles sur mes épaules de brute sélénite. Sieste sur ma chaise de jardin (le chat de ma voisine m’a réveillé en me léchant l'oreille droite), café expresso, vaisselle et retour dans l'enfance de Follain. Le merveilleux ne s'était pas envolé. Toujours cette formule de simplicité, cette façon de montrer et de ne jamais démontrer. Il faut chercher la simplicité. Soyons simples…
« Les grandes architectures de la nuit tombante : arcs de triomphe que formaient les branches au bout des avenues, labyrinthes des sentiers rafraîchis, stades des champs aux gradins de haies jusqu’à l’horizon, portiques et dolmens de nuages encadraient notre être enfant allant vers son destin. »
(Vous me pardonnerez ces quelques lignes mélangeant maladroitement style télégraphique et impressionnisme à la petite semaine.)
26 mai 2024.– Ciel se couvrant au fil de la journée et laissant deviner une certaine tendance orageuse pour les heures qui viennent (24°C). Ce matin, après mon tour de vélo, il y avait davantage de queue devant le fleuriste que devant la boulangerie, ce qui n'a pas manqué de m'étonner, car les queues dominicales devant cette dernière sont habituellement d'une longueur déjà quasi polonaise. Figurez-vous que, pas bien malin, je n'avais tout d'abord pas compris les raisons de ce que je constatais. Puis, soudain, tel le premier Claudel assommé par son pilier, j'ai ressenti comme une sorte d'illumination hébétée : aujourd'hui, c'était la Fête des Mères, cette vieille tradition pétainiste qui exige que l'on offre des fleurs une fois par an à sa maman ! Voilà donc ce qui explique la longueur de cette queue inhabituelle. Finalement, on est peu de choses. Pour rester dans les fleurs, cet après-midi, rempoté quelques géraniums et autres pâquerettes d'origine vaguement australe. Cette chose faite, retour dans le Canisy de Follain, et comme tout est dans tout, ces lignes : « Puis venait l'heure grave de l'arrosage des plantes en pot : une petite fille s'apprête à traverser la pièce avec un bol trop plein qu'elle tient avec une précaution immense, faisant mouvoir son jeune squelette, elle va passer, elle passe, elle est passée. »
27 mai 2024.– Pluie (18°C). Maussade comme le temps. Pas mis un pied dehors. Ah si ! J'ai sorti les poubelles ! Comme il le rappelle en citant José Ortega y Gasset, Follain est un homme qui aime simplement le passé. Oh, pas par traditionalisme — non, les traditionalistes veulent que le passé soit le présent — mais plutôt parce que le passé perd toute rudesse, parce que les vieilles pierres, les vieux murs, les vieux pavés et les fenêtres de notre enfance où l'on voyait se mouvoir des ombres ; tout cela n'accrédite pas le futur, tout cela rêve le futur : « En montant la rue Corne-de-Cerf, je frôlais de mes mains la rampe de fer qui avait perdu la chaleur du jour et prenais conscience du métal froid qui poursuivait son rêve de matière forgée. Puis, comme je regardais à nouveau tous les points brillants du ciel, mon père me redisait que certains étaient, à proprement parler, non pas des étoiles, mais des planètes où s'était peut-être, comme sur terre, répandue la vie. »
Demain, labeur…
28 mai 2024.– Beau temps, quelques nuages élevés (21°C). Ce matin, lever 5 h 00, soulevé un nombre considérable de produits manufacturés en Chine. Cet après-midi, entre la musique brésilienne de la voisine de droite et la tondeuse du voisin de gauche, vague impression d’assister à un concert de Throbbing Gristle. Dans de telles conditions, sieste impossible, lecture problématique. Malgré tout, picoré chez Cioran et Léautaud. Le calme revenu, sombré dans une sorte de narcolepsie qui n’avait rien de vraiment heureux. Ce sera tout pour aujourd’hui.
29 mai 2024.– Couverture nuageuse épaisse (21°C). Labeur, aucune satisfaction autre que pécuniaire. La prostitution n’est pas loin. Rentré, ce n’est pas mieux. Piaillements des voisines et de leurs enceintes Bluetooth. Sieste impossible, lecture impossible. Mon cerveau ne supporte plus la contention forcée, trop soutenue ou intempestive des bruits non désirés.
30 mai 2024.– Ciel plombé dégageant sous l’effet des rafales de vent et laissant peu à peu place à des teintes finalement saisonnières (21°C). Ce matin, lu Feu mon histoire d’amour d’Alain Bonnand. Cent quinze pages boulottées en moins d’une heure vingt. Pas mal du tout, vrai beau style entre des concisions dignes de Vivant Denon et quelque chose du vieux Chardonne et du jeune Berthet. Élégance, désinvolture un peu désincarnée, on apprécie tout ça. Et puis, aussi quelque chose de plus intriguant, de plus trivial. Le héros de Bonnand tombe dans les amours ancillaires comme on pourrait tomber dans les escaliers. Il se « tape » toutes les femmes de ménage du collège où il officie faiblement comme surveillant. On rigole presque, c’est toujours aussi bien écrit et, malgré la trivialité des situations, toujours élégant. Faut-il en conclure qu’en littérature le style fait tout et les situations relatées pas grand-chose ? (Ce livre date de 1988, c’est-à-dire il y a des millénaires. Aujourd’hui, au point où en sont rendus les « rapports » homme/femme, il ne serait peut-être même pas écrit et en tous les cas pas publié. D’ailleurs, Bonnand a presque disparu de la circulation.) Cet après-midi, entamé Vingt ans avant, volume résolument plus replet rassemblant un choix des chroniques que Bernard Frank avait données au Matin de Paris entre 1980 et 1985. Dans la préface, qui est épatante tout en n’oubliant pas d’être un peu drôle, il explique que, bien malgré sa réputation de lymphatique en chef, il a dû écrire plus de cinq mille pages de chroniques pour l’Observateur, Le Monde ou Le Matin de Paris, puis il conclut par ceci : « Comme on le voit, ce ne sont pas les projets qui manquent. Mais c’est si bien de ne rien faire. Et plus les jours nous sont comptés, plus il est doux de passer son temps. »
1er juin 2024.– Nuages, vent et pluie. Temps toujours épouvantable. Cela dure depuis bientôt trois mois. Faut-il s’en réjouir ? (18°C). Lu À l’ombre des majorités silencieuses de Baudrillard. Opuscule assez court, ce qui ne l’empêche pas d’être baudrillardesque en diable. L’ami Jean effectue de jolies pirouettes autour de la notion de masse, cette entité poussive et amorphe qui ne sera jamais un « sujet » moral ou politique mais plutôt une sorte de trou noir qui absorberait toute énergie, toute information pour mieux ne rien en faire. Bref, pour lui, la masse (silencieuse) n’est qu’un concept inventé pour mieux faire disparaître la politique (au sens noble, celui de la vie de la cité), un symptôme de l’hyperréalité. Soit une réalité simulée, une réalité non réelle. Évidemment, énoncé comme cela, le menu pourrait paraître un peu lourd à digérer. Il n’en est rien, car toutes ces fines théories sont peintes avec des couleurs croquignolettes, des couleurs de poète illuminé par ses propres idées (on pourrait dire que Baudrillard, c’est plus que de la sociologie, ou alors une « autre » sociologie). Le bouquin offre un autre petit texte en conclusion. Il y est question d’extase et de socialisme. Permettez-moi de trouver ce qui suit un peu marrant : « L’hypothèse serait que nous sommes actuellement en France dans une forme extatique du socialisme. Il n’est que de voir l’extase funèbre du visage de Mitterrand. L’extase caractérise généralement le passage à l’état pur, dans sa forme pure, d’une forme sans contenu et sans passion. L’extase est antinomique de la passion. »
2 juin 2024.– Bruine et brouillard, vent aigrelet. Un temps de Toussaint. Faut-il vraiment que je tamponne le trop fameux « réchauffement climatique » ? En attendant, j’ai froid aux pieds (15°C). Lu cent pages de Vingt ans avant. Ce spicilège de chroniques me semble pour l’instant un peu trop lié au marigot politique et au tout petit monde littéraire du début des années quatre-vingt. Grande présence du socialisme mitterrandien, beaucoup de règlements de comptes avec Pauwels et d’Ormesson, quelques batailles de chiffonniers avec le Fig Mag. Reste que quand Frank parle d’autre chose, de livres par exemple, c’est tout à fait rond, gourmand, délicieux.
Des questions ? Mes réponses au questionnaire que l’on dit de Bolaño :
Quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit ?
Rien.
Quelle est la différence entre ce mot et le mot « écrivain » ?
C’est un peu l’inverse, un écrivain c’est souvent celui qui remplit.
Qu’est-ce que la littérature française ?
Parfois c’est une idée de la tragédie grecque revisitée par le romantisme allemand, ce qui donne une certaine douceur : Giraudoux, par exemple. Parfois, c’est tout autre chose.
Camões, Álvaro de Campos ou Gonçalo M. Tavares ?
Alberto Caeiro.
Que pensez-vous de la « littérature mondiale » ?
À peu près autant de choses que de la littérature neptunienne.
Emily Dickinson, Kafka ou Kae Tempest ?
Franz, mais j’aime beaucoup Emily.
Bruce Springsteen, Rihanna ou Godspeed You! Black Emperor ?
Bruce, évidemment.
Quel est le meilleur roman d’António Lobo Antunes ?
António Lobo qui ?
Si vous l’aviez connu, qu’auriez-vous dit à Pessoa ?
Comment faites-vous pour gérer tout ce petit monde ?
Et à Salazar ?
Dans ta gueule, Tapioca !
Avez-vous déjà versé des larmes à cause de critiques adverses ?
Oui, des larmes de joie.
Avez-vous déjà ressenti la faim féroce ? Le froid jusque dans la moelle des os ? La chaleur qui coupe le souffle ?
Oui, oui et oui. Ce qui fait beaucoup de oui.
Avez-vous déjà marché dans le désert ? Si oui, pourquoi ?
Pas à ma connaissance, mais je suis monté en haut de la dune du Pilat.
3 juin 2024.– Temps toujours abominable, vent, averses, quasi froideur. Ceci dit, au moment où j’écris ces lignes, un peu d’espoir, presque un miracle : une éclaircie (16°C). Sur le fleuve Amour de Joseph Delteil. Deux jeunes gandins officiers de l’Armée Rouge tombent amoureux d’une voluptueuse Ludmilla, commandante d’un régiment de femmes de l’armée tsariste. Ils changent de camp par amour, désertent, la suivent jusqu’à Shanghai, rencontrent un petit télégraphiste bleu, les cadavres tombent, l’amour perdure… Voilà pour l’intrigue hautement improbable, un prétexte de pacotille qui permet à Delteil de déployer une prose plus poétique et luxuriante que mon coude gauche. Pour tout dire, c’est assez merveilleux, plein de couleurs chamarrées, d’humour en sous-main et de délicatesses cachées. Adoubé par Breton, Delteil fut une petite vedette littéraire au milieu des années vingt (du siècle dernier). On le verra ensuite de biais, car pas assez moderne, finalement trop paysan. Or, c’est ce qu’il était : paysan, vigneron et Languedocien. Rien de truqué dans son art, non, plutôt un don naturel, de la verve et de la candeur, un art pour les calembours, les coq-à-l’âne et les épithètes de cape et d’épée. Quelque chose de fruité, mais en beaucoup mieux que ce que j’en dis.
Après avoir volé la mine avec laquelle j’ai écrit ces mots, le chat de ma voisine vient d’emporter mon modeste feuillet. Va-t-il le lire ?
4 juin 2024.– Quelques belles éclaircies (22°C). Effectué une dizaine de kilomètres de psychogéographie pédestre qui m’ont mené au pied d’une pagode où j’ai fini Le Fleuve Amour de Delteil. C’était assez ton sur ton, en tout cas plein de couleurs mélangées. Rien à redire. Rentré dans mon petit home sweet home, j’ai bien vite retrouvé ma chaise de lecture sur laquelle j’ai poursuivi les chroniques de Bernard Frank que j’avais entamées avant-hier. Le chat de la voisine me regardait avec un lézard gigotant dans la gueule. C’est charmant, mais je pense que si j’étais plus petit et que le félin miniature de ma voisine était plus grand, c’est moi qui gigoterais entre ses crocs. Ceci dit, et pour en revenir à ce qui devrait nous occuper, c’est-à-dire la lecture, il faut savoir que le Frank chroniqueur est toujours joueur. On l’imagine aisément avec quelques écrivains gigotant dans sa belle gueule de gourmet lymphatique. Ici, il évoque beaucoup Nimier, un peu Morand, surtout, il donne de jolis coups de patte à Gide et à ses relents antisémites guère dissimulés. (C’est bien simple, on se demande comment Gide a bien pu passer le tamis à la Libération.) Moins appétissant : le labeur que je reprendrai demain. Sans entrain, comme d’habitude.
5 juin 2024.– Beau temps chaud, comme si c’était possible ! (28°C). Labeur, fatigue, rien lu. On pourrait croire que ce qui souffre durcit, mène à une prise de conscience plus profonde de la réalité et, parfois, à une sorte de sagesse détachée. Tout cela est certainement vrai, mais peut-être pas pour tout le monde. Par exemple, mes souffrances ne durcissent jamais vraiment et me rendent plutôt vaporeux et éloigné du réel, tout en ne m’apportant qu’une sorte de molle nervosité assez oxymorique. Disons que je suis un lymphatique en pire.
7 juin 2024.– Orages (25°C). Rien mais alors rien du tout. Une sorte de vide humide.
8 juin 2024.– Queue d’orage laissant place à un temps à demi nuageux mais bien chaud (28°C). Douleurs cervicales tenaces. Matin : coiffeur, ménage, joué avec le chat (qui est en fait une chatte). Déjeuner : tomates farcies, rosé. Sieste puis cinq chroniques de l’animal Frank lues sur ma chaise de jardin. J’en suis là. Ce soir, vie sociale, peut-être un restaurant. En tout cas, certainement quelques volutes alcoolisées en perspective.
9 juin 2024.– Éclaircies et passages nuageux parfois denses. Du vent. Humidité encore latente (23°C). Trop bu hier soir, encore vaporeux ce matin. Cela ne m’a pas empêché de faire mes quinze kilomètres de vélo, en zigzaguant. Malgré tout, rentré à bon port, attaqué assez mollement la lecture de Quelques pas ensemble, un opuscule dématérialisé d’Yves Martin trouvé sur un dangereux site de partage informatique assez prohibé par les autorités. Yves Martin, voilà un type qui m’intrigue depuis belle lurette. Que voulez-vous, son amour pour les petites filles et les prostituées, ses descriptions d’un Paris populaire et oublié, sa demi-clochardisation non avouée, mais pas du tout simulée. Sa poésie un peu tanguante et son faux laissé-aller d’ancien clerc de notaire. Tout cela me sied pour ainsi dire tout à fait. Seul petit hic, les trente pages que j’ai lues ce matin me sont passées au-dessus de la tête et je n’y ai trouvé que la vague mélodie d’une « petite musique » (je suis injuste, je suis vaporeux). Valises, demain départ pour la Bourgogne, Autun et les franges du massif du Morvan.
10 juin 2024.– Autun. Beau temps à peine dérangé par une courte cohorte de nuages (21°C). Sacrifice d’une andouillette, foie gras et ris de veau. Ma première journée autunoise aura été consacrée au plaisir des calories et à l’augmentation de mon cholestérol (je ne parlerai pas des boissons fermentées).
11 juin 2024.– Autun, ciel très nuageux se dégageant presque totalement (21°C). Visite des vestiges de la ville romaine, de ceux de la ville médiévale. Autour de ces vestiges et d’un centre historique assez joli, ce qui pourrait bien tenir de la « France périphérique ». D’autres vestiges, ceux des petits commerces abandonnés. La féerie morose des devantures désertées, un centre commercial patibulaire, des ronds-points et des logements sociaux au milieu des champs, dignes des temps collectivistes. Tout cela expliquant peut-être un peu le résultat des élections d’avant-hier.
12 juin 2024.– Autun. Ciel se couvrant au fil de la journée (18°C). Ascension du Mont Beuvray, exercice mitterrandien s’il en est. Mort de Françoise Hardy, tristesse.
13 juin 2024.– Autun. Beau temps ! (21°C). Un peu de route. Visite de Châteauneuf (château et petit bourg médiéval, charmant). Quelques kilomètres de dérive sur des routes communales, virant parfois au chemin vicinal. Croisé quelques tracteurs et presque rien d’autre.
14 juin 2024.– Autun. Journée globalement pluvieuse (21°C). Matin : musée. Après-midi : randonnées de faible intensité. Croisé quelques vaches…
15 juin 2024.– Nuages et éclaircies (22°C). Retour de Bourgogne. Retour sur ma chaise de jardin. Retour dans les Cahiers de Cioran.
16 juin 2024.– Quasi beau temps, rattrapé par une petite armée de nuages (24°C). Climat politique délétère, cervicalgie avec quelque chose de vaguement nauséeux, rien de bon, pas plus à l’extérieur qu’à l’intérieur. Néanmoins, petit tour de vélo, quatre chroniques de Bernard Frank, découverte de Michel Torga (sorte de Camus lusitanien). Il ne faut pas se laisser abattre.
17 juin 2024.– Large offensive estivale. Comme si c’était possible ! (28°C). Dix kilomètres à pied. Parcs et jardins. Guère de fureur, mais du bruit dans les deux. Trouvé un refuge relativement stratégique dans un tout nouveau petit square où, plus à l’ombre d’un platane que d’une jeune fille en fleur, j’ai lu Race et mémoire, une courte plaquette de Claude Lévi-Strauss (tout étant dans tout, le banc sur lequel j’ai posé mon modeste séant était orné de deux croix celtiques et de ce slogan : « France blanche »). Chez Lévi-Strauss, aucun petit poing brandi face au pire, non, plutôt une certaine finesse d’analyse. Il parle certes un peu de Gobineau et de sa théorie du non-mélange, mais surtout de différences culturelles, de la place de la civilisation occidentale, de la relativité de l’idée de progrès. J’imagine qu’aujourd’hui tout cela est un peu vu de biais par la doxa dominante. D’ailleurs, aux dernières nouvelles, Lévi-Strauss serait presque passé du côté du tendancieux : « On va souvent jusqu’à priver l’étranger de ce dernier degré de réalité en en faisant un « fantôme » ou une « apparition ». Ainsi se réalisent de curieuses situations où deux interlocuteurs se donnent cruellement la réplique. Dans les Grandes Antilles, quelques années après la découverte de l’Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d’enquête pour rechercher si les indigènes possédaient ou non une âme, ces derniers s’employaient à immerger des blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leur cadavre était, ou non, sujet à la putréfaction. ». Après-midi consacrée à une non-activité sereine et relâchée. Sieste prolongée puis match de balle au pied télévisé (une compétition continentale venant de débuter, j’imagine qu’elle m’accaparera assez les quelques semaines qui suivent).
18 juin 2024.– Premières chaleurs. Impression de passer de Reykjavik à Marrakech sans passer par Cork ou Paimpol (30°C). Matin, marche. Tous les deux ou trois kilomètres, différence des paysages, de l'architecture, de la sociologie des bâtiments même. Accorder tout cela aura tenu jusqu'à présent de la gageure, mieux, du miracle. Cela ne durera certainement pas, car tout ce qui se construit aujourd'hui semble être assommé par une sorte de catéchisme où les différences se noient dans une sorte d'ode au mélange qui tend à l'indistinction. Dans ce nouveau monde qui se fabrique, point d'accord, ou alors un accord neutre où plus rien ne se permet de sonner de guingois. Les nouveaux quartiers sont ainsi faits, voulant faire place aux différences, ils en deviennent indifférents, neutres et monocordes, sans musique et c'est bien là le problème du manque de frontières (évidemment, je ne parle pas de frontières autrement qu'en les voyant symboliques). Pour le reste, entre deux pas, je me suis réservé quelques pauses de lecture et suis retourné dans le Journal de Green. Rien à redire, il est toujours très cochon.
Après-midi, examen médical saumâtre. Demain, reprise du labeur.
20 juin 2024.– Nette tendance orageuse (28°C). Labeur. Sieste. Football télévisé. Mort de James White (ou Chance), freluquet no wave, sax maniac… Pour l'occasion, je ressors ce petit texte écrit il y a une dizaine d'années. Ce sera mon hommage :
Quel drôle de vilain petit canard, ce James Chance ! À vouloir être James Brown, Albert Ayler ET Iggy Pop à la fois ! Tout blanc par-dessus le marché ! Vraiment n’importe quoi ! James Siegfried en fait (ça ne s’invente pas), petit lactescent maigrichon qui, fraîchement débarqué de son gloupissant Wisconsin, commence à faire le zozo dans les poubelles du Lower East Side new-yorkais… Poum, vlan, tchac ! On s’enfile de l’héro iranienne plus facile à trouver que la soupe Campbell. On se tortille tel l’épileptique moyen chez la pythie no-wave Lydia Lunch. On fait le zozo dans des formations free-jazz sous le regard affligé de types trop cools, et finalement, car il faut bien faire le malin, on s’attache bientôt à démembrer les cadavres de la soul, du rock et du jazz en leur insufflant une effarante succession d’électrochocs… Vlan ! Voilà donc un saxo pas langoureux, strident et tapageur, ça crisse sec. En sous-main, une guitare lacère le carambolage rythmique avec la régularité d’un psychotique armé d’un assez problématique coupe-chou. Chance, très freluquet, quand il lâche sa simili trompette, glapit ton sur ton des choses peu aimables et pas palimpseste en surcouche sur le tintamarre. Les Contorsions ! Le truc de James Chance : les contorsions ! Avec cette certitude que finalement ce qui compte vraiment pour lui, chétif blanc-bec tout maigre… eh bien… c’est la confrontation (les contorsions ?) avec le public… pas uniquement l’agression sonore qui carambole les esgourdes, non surtout la vraie, la bien physique chiffonnade ; celle qui passe par Iggy Pop et se souvient de la croquignolette pâtisserie des sinistres explosés actionnistes viennois ! Alors voilà, on démolit le visage d’un type à coups de saxophone alto (on altère le type), on mord le téton d’une fille, on tire très fort les cheveux d’une autre, on se jette sur une triste assistance de quidams lénifiés, on les gifle pour les réveiller un peu, on remonte sur scène le visage en sang, et hop ! c’est reparti pour un embrouillamini de saxo qui picote les oreilles avec la délicatesse d'une pelote d'épingles rouillées. Ce n’est plus de la musique, c’est du Pollock in vivo avec des secrétions, des démangeaisons, une masse crispée qui explose à la gueule… pur prurit de salopard sans conscience. Plus tard, devenu attraction no-wave, notre aigrefin se fait irascible, sax maniac tyrannique et métronomique avec ses musiciens, forçant le tempo dans une vitesse inabordable au commun des mortels. C’est lui le chef, c’est lui qui souffle. Il se trouve une sorte de Yoko Ono (Anya Phillips) qui l’habille et sème la zizanie. Il sort des disques encore tous raides de la scène (Buy The Contortions), d’autres quasi écoutables (Off White), se roule dans des postures aristocratiques « Je ne veux PAS avoir de rapport avec les gens ! » De Chance, il devient White, plus abordable… disco funky et moins punk jazz, toujours hargneux et encore raide, toujours aussi peu noir alors qu’il voudrait assurément l’être un peu… noir. Sa Yoko à lui meurt d’un cancer. Bientôt, il disparaît… quasi… et réapparaît… parfois. La musique est encore là ; avec la fragrance, la raideur, les yeux exorbités et les os qui craquent d’un héroïnomane tombé depuis quinze jours au pied de l’escalier. Du no bidule funky nihiliste pas pire que les DNA, qui eux jouaient avec des moufles… mais c’est une autre histoire.
To be continued.
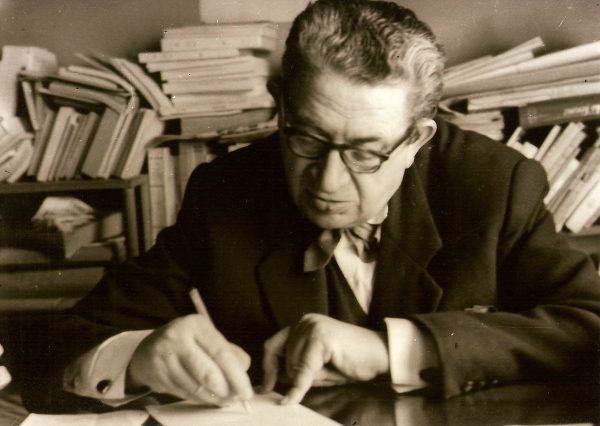
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire